Observatoire des impayés : vers une réponse coordonnée aux défaillances locatives ?
SOMMAIRE
Face à la recrudescence des impayés de loyers et à l'accélération des expulsions locatives, Valérie Létard a convoqué, le 5 mai dernier, l'ensemble des acteurs du logement autour de l'Observatoire national des impayés.
Dans un contexte économique tendu, marqué par l'inflation et la fragilisation des revenus, cet Observatoire entend se muer en outil d’alerte opérationnel, capable d’anticiper les défaillances et de coordonner les réponses. Focus...
Un record d'expulsions locatives en 2024
« Un million et demi de ménages connaissent chaque année un incident de paiement », a rappelé la ministre. Parmi eux, près de 500 000 reçoivent un commandement de payer. Si une partie de ces cas sont résolus par le dialogue ou l'intervention des services sociaux, la procédure reste une première étape qui peut aboutir à l’expulsion.
En 2024, la France a enregistré un nombre record de 24 556 expulsions locatives avec le concours de la force publique, soit une hausse de 29 % par rapport à 2023, et une progression astronomique de 150% en 20 ans, selon les chiffres relayés par La Monde et France Culture. Les tensions sur le pouvoir d’achat, liées à la flambée des prix de l’énergie et de l’alimentation, fragilisent de plus en plus de foyers.
Les effets de la loi Kasbarian-Bergé

Selon La Fondation pour le Logement, Les effets de la loi « Kasbarian-Bergé », adoptée en 2023, se font déjà durement sentir sur le terrain. Jugée régressive par de nombreuses associations et préoccupante par l'ONU et la Ligue des Droits de l'Homme, cette législation a profondément modifié la gestion des expulsions locatives.
Les ménages en difficulté obtiennent désormais plus rarement des échéanciers ou des délais pour quitter leur logement. Les procédures d’expulsion se déroulent à un rythme accéléré, tandis que les préfectures prennent peu en compte la situation sociale des locataires ou l’existence de recours judiciaires encore en cours. Pour les acteurs associatifs, ces nouvelles pratiques marquent un tournant préoccupant dans le traitement de la précarité résidentielle.
Thibaut Spriet, secrétaire national du Syndicat de la magistrature, dresse quant à lui un constat préoccupant sur la gestion des impayés de loyer : « il y a de plus en plus de procédures lancées pour de petites dettes », tandis que « les possibilités et les délais pour trouver des solutions ont été considérablement réduits ».
Saturation des logements d'urgence
Les associations insistent sur la nécessité d’éviter les expulsions, souvent synonymes de rupture sociale.
La Fondation Pour le Logement des Défavorisés (ancienne Fondation Abbé Pierre) ou la CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie) rappellent que les dispositifs de relogement d’urgence sont saturés.
Chaque jour, plus de 5 700 personnes appelant le 115 se sont vu refuser une place, malgré un parc de plus de 200 000 places. Cette situation est aggravée par des fermetures prévues de centres d’hébergement, comme celui de Tours, qui devait fermer 80 places le 2 avril 2024, affectant une trentaine d’enfants et leurs familles.
Des dispositifs d’accompagnement encore trop dispersés
Les outils d’accompagnement des ménages en difficulté existent, mais leur efficacité reste limitée par un manque de coordination et de lisibilité pour les usagers comme pour les professionnels.
Le principal levier d’aide directe reste le Fonds de solidarité pour le logement (FSL). Cofinancé par les départements et l’État, il mobilise environ 330 millions d’euros par an. Ce fonds intervient pour accorder des aides financières aux locataires en situation précaire : règlement d’arriérés de loyers, dépôt de garantie, frais d’installation, voire prise en charge ponctuelle de factures d’énergie. Pourtant, les modalités d’attribution varient sensiblement d’un territoire à l’autre, et les délais de traitement peuvent freiner les mesures d’urgence.
Autre maillon clé du dispositif : les CCAPEX, ou Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions. Présentes dans chaque département, elles rassemblent les services de l’État, les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et les associations pour examiner les situations individuelles à risque et coordonner des solutions.
En 2025, l’État leur consacre 3,7 millions d’euros, un soutien reconduit pour favoriser leur fonctionnement. Mais sur le terrain, ces commissions peinent parfois à intervenir suffisamment tôt dans la chaîne du contentieux locatif . Trop souvent, les signalements arrivent une fois la procédure judiciaire déjà enclenchée, rendant les marges de manœuvre plus étroites.
Depuis 2021, le gouvernement a expérimenté un autre outil : les équipes mobiles de prévention des expulsions, composées de juristes et de travailleurs sociaux.
Déployées dans 26 départements, ces cellules ont pour mission d’aller directement à la rencontre des locataires en difficulté, souvent isolés, pour les informer de leurs droits, les aider à monter des dossiers FSL ou les orienter vers les bons interlocuteurs. Ce dispositif proactif a montré son efficacité dans certains territoires, mais reste limité en couverture géographique. Plusieurs associations appellent à son extension à l’échelle nationale.
Malgré ces dispositifs, les résultats demeurent inégaux, et les ruptures de parcours sont fréquentes.

Un Observatoire pour coordonner les réponses
L’Observatoire national des impayés, mis en place en 2021 à la suite de la crise sanitaire, a été conçu comme un espace de dialogue entre les parties prenantes : ministères, bailleurs sociaux, représentants de locataires, FSL, ADIL, agences de l’Etat.
Il a pour mission de collecter et d'analyser des données relatives aux impayés locatifs afin d'informer les politiques publiques et de prévenir les expulsions.
Lors de la réunion du 5 mai, Valérie Létard a appelé à renforcer ce rôle de coordination : « Il est urgent de mieux repérer les fragilités en amont et d’agir avant l’engrenage de la dette locative ».
La ministre a missionné la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) pour piloter un plan d’actions. Celui-ci devra proposer des solutions concrètes, dans un calendrier resserré. Une nouvelle réunion est annoncée pour l’automne 2025.
1,4 million de bailleurs non imposables selon la FNAIM
Pour les bailleurs, notamment les petits propriétaires, l’impayé n’est pas qu’un problème social : c’est un manque à gagner qui peut être fortement préjudiciable.
La Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM) a publié des données détaillées sur les bailleurs particuliers en France dans son rapport "Le logement en France et en Europe" de 2023. Selon ce document, en 2021, la France comptait environ 5 millions de bailleurs particuliers détenant des logements, des locaux commerciaux, des commerces et des terrains. Parmi eux, 27 % étaient non imposables, ce qui représente environ 1,4 million de bailleurs.
Dans ce contexte, la ministre souhaite encourager une logique de "gagnant-gagnant" : accompagnement renforcé pour les locataires, sécurisation des loyers pour les bailleurs.
Vers un plan d’actions à l’automne
Les réflexions doivent converger vers un plan d’actions cohérent. La DIHAL a pour mission de proposer un ensemble de mesures concrètes à mettre en œuvre d’ici fin 2025. Parmi les pistes explorées :
- la création d’un fichier anonymisé des situations d’impayé,
- le renforcement des aides d’urgence,
- la simplification de l’accès aux dispositifs de prévention.
Ce travail se fera en lien avec les parlementaires, notamment Marc-Philippe Daubresse et Mickaël Cosson, auteurs d’un rapport en cours sur la relance de l’investissement locatif. L’enjeu est clair : éviter que les propriétaires se retirent du marché locatif en raison d’un climat d’insécurité financière.
Dans une France où les expulsions ont atteint un niveau jamais vu depuis dix ans, la mobilisation souhaitée par Valérie Létard sonne comme un signal d’alerte. La question des impayés de loyers, longtemps traitée à la marge, devient un enjeu central de la politique du logement. Reste à voir si la coordination entre acteurs saura prévenir plutôt que guérir.
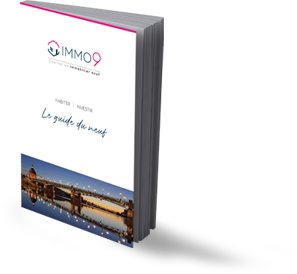

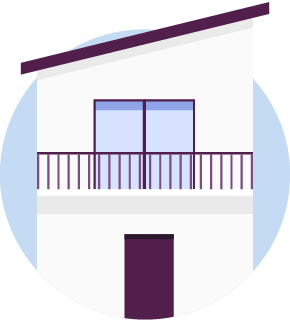
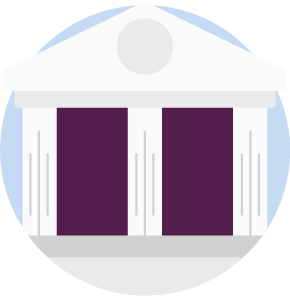

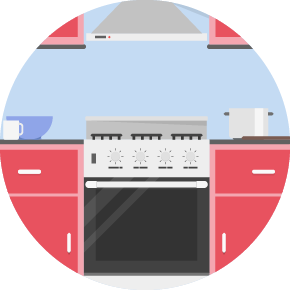



 Morgane Caillière
Morgane Caillière




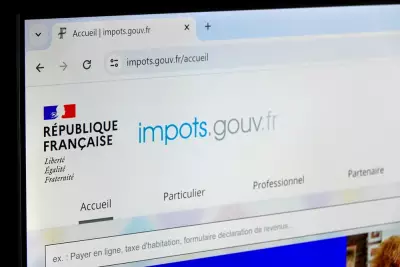







Commentaires à propos de cet article :
Ajouter un commentaire